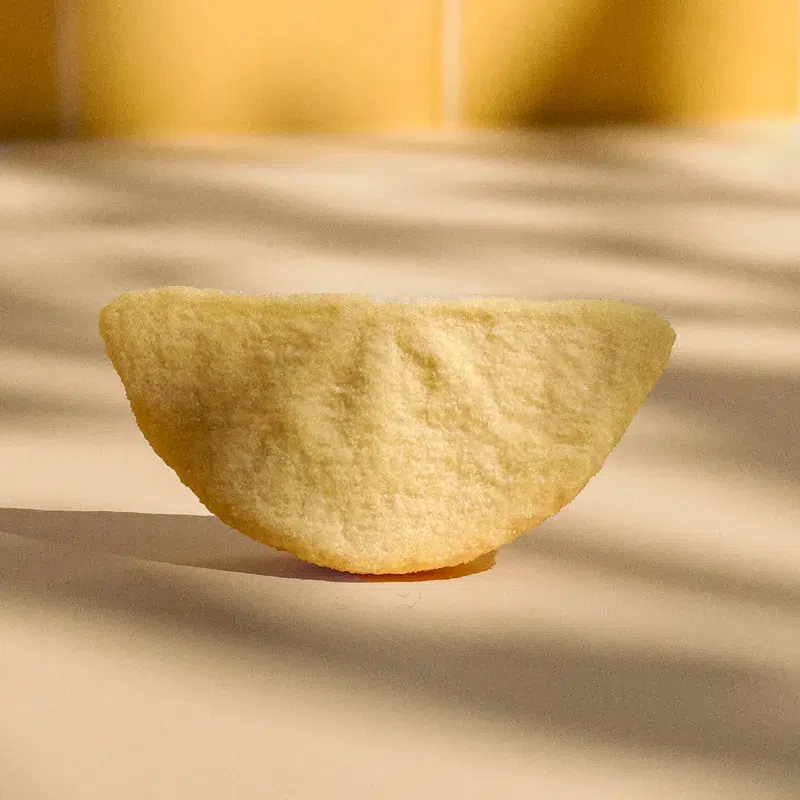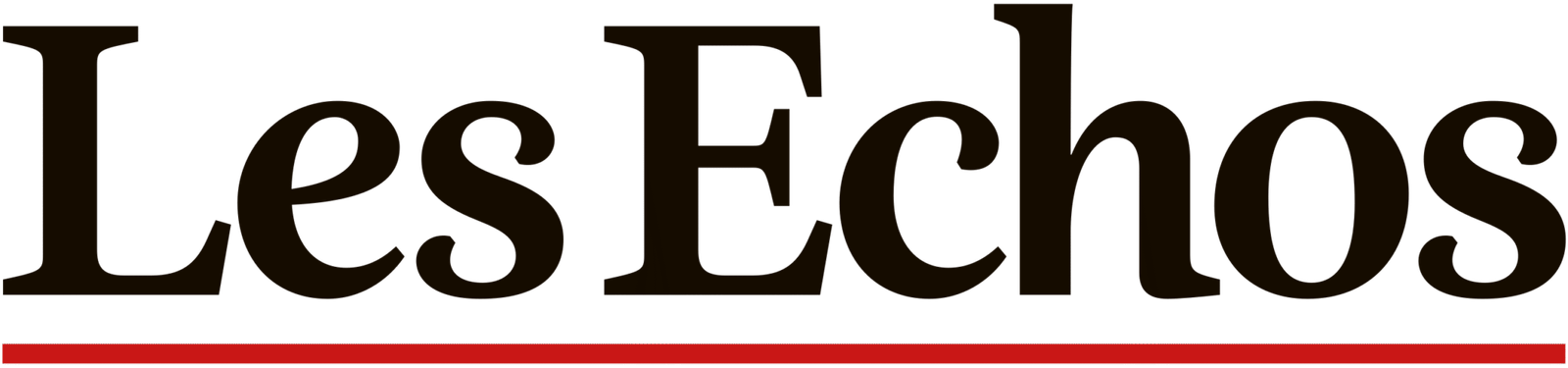Depuis de nombreuses années, la guerre contre le plastique à usage unique a été déclarée. Pailles en papier, sacs biodégradables, bouteilles végétales… La révolution semblait en marche avec des recherches de matières alternatives, biodégradables et sans conséquence pour la santé. Le plastique représente une menace réelle et immédiate pour notre environnement. Chaque année, ce sont plus de 8 millions de tonnes de plastique qui se déversent dans nos océans1, mettant en danger la faune marine et les écosystèmes. Un simple sac plastique peut mettre jusqu’à 450 ans pour se dégrader2, laissant derrière lui des microplastiques qui s’infiltrent maintenant jusque dans notre chaîne alimentaire.
Il est donc indiscutable que nous devons réduire drastiquement notre consommation de plastique. Pourtant, si ces initiatives méritent d’être saluées et encouragées, ne passons-nous pas à côté du véritable enjeu ?
Au-delà du contenant, repensons le contenu
Le problème principal ne se trouve peut-être pas tant dans le matériau qui emballe nos produits (même si nous l’avons dit, le plastique EST un problème), mais dans ce qu’il contient. Prenons un exemple frappant : la plupart des boissons traditionnelles achetées au supermarché, sont constituées à plus de 98% d’eau. Oui, vous avez bien lu. Nous transportons, commercialisons et consommons majoritairement… de l’eau. De l’eau plus ou moins aromatisée, plus ou moins additivée, plus ou moins polluée en microplastique, mais de l’eau ! Cette même eau que nous avons à disposition gratuitement chez nous et dans beaucoup d’espaces publics.
Demain, si nous parvenons à remplacer le plastique par un matériau plus écologique – et nous y arriverons probablement – aurons-nous réellement résolu le problème ? La réponse est non. Nous aurons simplement déplacé la question sans traiter sa racine.
Le véritable coût caché : le transport de l’eau
Imaginons ensemble l’absurdité de la situation actuelle : des millions de litres d’eau sont embouteillés, transportés sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, alors que la plupart d’entre nous disposent d’eau potable directement à domicile.
Ce transport massif engendre une empreinte environnementale considérable. Saviez-vous que le transport représente plus de 60% de l’impact carbone total d’une boisson liquide3 ? Cette statistique alarmante nous montre l’ampleur du problème lié à la distribution de produits constitués majoritairement d’eau.
Plus frappant encore : la fabrication d’un seul litre de soda nécessite jusqu’à 70 litres d’eau4
Ce chiffre prend en compte l’ensemble du processus de production. Une consommation d’eau démesurée dans un monde où cette ressource devient de plus en plus précieuse.
Comme le disait si bien cette pub des années 90 : “Pourquoi aller chercher loin ce qu’on a près de chez soi ?” (Clin d’œil à notre génération qui s’en souvient peut-être !)
Et justement, parlons-en de cette eau du robinet ! Accessible, contrôlée, économique, elle est désormais au cœur des politiques publiques qui visent à la rendre disponible et sûre partout sur le territoire. Des fontaines sont installées dans les espaces publics, les réglementations sur sa qualité sont de plus en plus strictes… Tout est mis en œuvre pour que cette ressource précieuse soit à la disposition de tous, gratuitement et en toute sécurité.
Nous ne rentrerons pas dans le débat des eaux en bouteilles. Les différentes enquêtes ont démontré leurs nocivités.
La hiérarchie oubliée des 3R
Nous connaissons tous le mantra écologique : Réduire, Réutiliser, Recycler. Mais avons-nous remarqué l’ordre de ces actions ? Il n’est pas aléatoire !
- Réduire : La première étape, la plus efficace, consiste à diminuer notre consommation à la source.
- Réutiliser : Ensuite seulement, nous devons maximiser l’usage de ce que nous consommons déjà.
- Recycler : En dernier recours, nous recyclons ce qui ne peut être ni réduit ni réutilisé.
Trop souvent, nous nous focalisons sur le recyclage, alors que la réduction devrait être notre priorité absolue.
Alors, que faire concrètement ?
Repenser notre rapport aux boissons industrielles implique de :
- Privilégier des boissons solides ou concentrées qui réduisent drastiquement les volumes transportés
- Favoriser les alternatives locales qui limitent les distances parcourues
- Investir dans des contenants réutilisables plutôt que recyclables
- Exiger plus de transparence sur l’impact écologique global des produits
Comme ces moments où l’on sortait le sirop de menthe pour les goûters d’été, redécouvrons le plaisir de préparer nous-mêmes nos boissons, avec un impact minimal sur notre planète. L’utilisation de boissons solides ou solid drinks prennent ainsi tout son sens.
Le plastique à usage unique est un problème sérieux, certes. Mais ne nous arrêtons pas à la surface des choses. La vraie révolution commence lorsque nous interrogeons non seulement comment nous emballons, mais aussi ce que nous emballons et pourquoi nous le faisons.